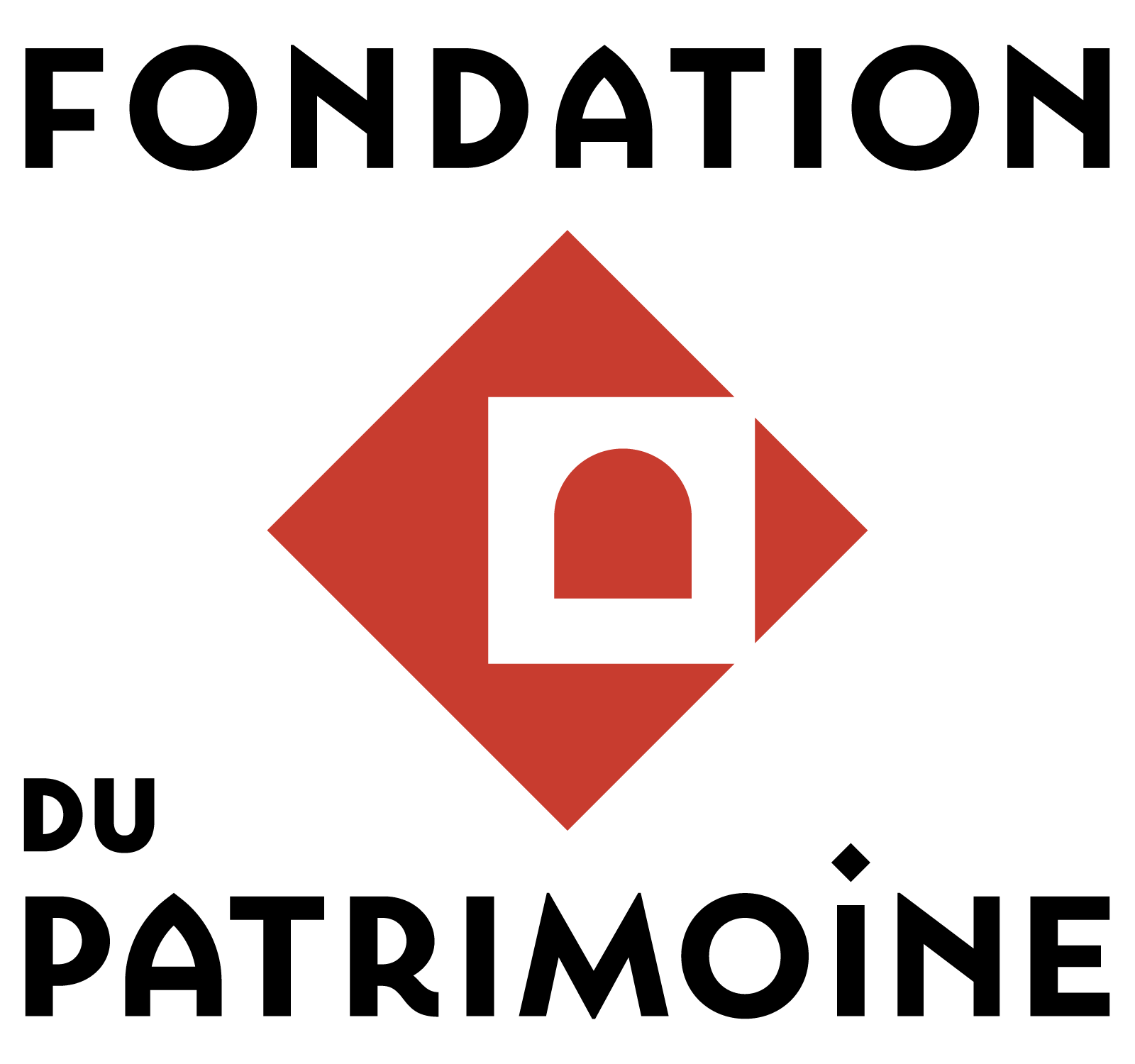Pourquoi et comment préserver la biodiversité dans le bâti ancien ?
Chauves-souris, hirondelles, moineaux... Le bâti ancien est un refuge essentiel. Découvrez les bonnes pratiques pour concilier patrimoine et écologie.
Le bâti ancien, avec ses pierres façonnées par le temps, abrite bien plus qu’un patrimoine architectural : il est aussi un refuge précieux pour la biodiversité. Hirondelles, martinets, chauves-souris… de nombreuses espèces dépendent de ces édifices pour s’abriter, se reproduire, survivre. Pourtant, les restaurations du bâti mal pensées et l'artificialisation des sols menacent ces écosystèmes discrets, mais essentiels.
Comment préserver cette richesse naturelle tout en sauvegardant notre héritage bâti ? Découvrez les enjeux et les solutions concrètes portées par la Fondation du patrimoine et la LPO.
La biodiversité, un enjeu crucial pour notre avenir
La biodiversité est essentielle au bon fonctionnement des écosystèmes et à notre bien-être. Elle garantit des services vitaux comme la pollinisation, la régulation du climat et l'épuration de l'eau. Pourtant, les populations de vertébrés sauvages ont chuté de 73 % en 50 ans, mettant en danger non seulement la faune et la flore, mais aussi l’équilibre de nos sociétés. Cette perte entraîne des conséquences directes.
Par exemple, le déclin des insectes pollinisateurs comme les abeilles entraîne une baisse des rendements agricoles, ce qui a des implications économiques et sanitaires.
À contrario, en milieu urbain, la présence d’arbres réduit significativement la température ambiante lors des vagues de chaleur, limitant ainsi les risques pour la santé des populations vulnérables.
Le bâti ancien : un rôle clef dans la préservation de la biodiversité
La place du bâti ancien dans l’écosystème des milieux construits
Les bâtiments anciens jouent un rôle essentiel dans nos écosystèmes urbains et ruraux. Contrairement aux constructions modernes aux façades lisses, le bâti traditionnel présente des anfractuosités, des fissures et des matériaux naturels qui offrent des refuges idéaux pour la faune sauvage. Ces structures servent de sites de repos, de reproduction et d'hivernage pour diverses espèces.
Un habitat pour de nombreuses espèces
Certaines espèces dépendent en partie des structures humaines pour accomplir leur cycle de vie. Parmi elles, on retrouve :
- L'hirondelle de fenêtre (Delichon urbicum), qui construit son nid en forme de coupe sous les avancées de toit.
- Le moineau domestique (Passer domesticus), qui utilise les interstices des murs pour nicher.
- Les chauves-souris, telles que la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus), qui s'abritent dans les combles et les fissures des bâtiments.
La disparition ou la rénovation inadaptée de ces habitats entraîne un déclin dramatique des populations concernées. Par exemple, les populations d'Hirondelle de fenêtre ont diminué de 23,3 % entre 2001 et 2019, tandis que le Martinet noir a subi une baisse de 46,2 % sur la même période (source : LPO).
Une complémentarité entre patrimoine architectural et patrimoine naturel
Le bâti ancien et ses abords, tels que les jardins, douves et cours intérieures, constituent de véritables écosystèmes. Les espèces du bâti y trouvent non seulement des sites de nidification, mais également des ressources alimentaires.
Par exemple, les chauves-souris jouent un rôle crucial dans la régulation des populations d'insectes nuisibles, contribuant ainsi à la santé des jardins et à la durabilité des édifices.
De même, les hirondelles et les martinets participent à la réduction des populations de moustiques, améliorant le confort des habitants.
Ainsi, préserver le bâti ancien, c'est également favoriser la biodiversité et renforcer les services écosystémiques bénéfiques à nos sociétés.
Les menaces qui pèsent sur la biodiversité du bâti ancien
Les rénovations sans prise en compte de la biodiversité : un danger pour la faune ?
Les travaux de réhabilitation, notamment ceux visant à améliorer l'isolation thermique des bâtiments anciens, peuvent involontairement détruire des habitats essentiels pour la faune.
En condamnant des cavités ou en supprimant des accès aux toitures, ces interventions éliminent des sites de nidification ou d'abri pour des espèces comme les chauves-souris ou les hirondelles.
Artificialisation des sols et disparition des ressources naturelles
L'urbanisation croissante entraîne une artificialisation des sols, c'est-à-dire la transformation d'espaces naturels ou agricoles en zones bâties ou imperméabilisées.
Ce phénomène réduit les habitats naturels et les ressources alimentaires disponibles pour la faune. Par exemple, la conversion de prairies en parkings ou en zones commerciales prive les insectes pollinisateurs de fleurs nécessaires à leur survie, impactant ainsi toute la chaîne alimentaire.
Entre 2013 et 2023, environ 24 000 hectares d’espaces naturels, agricoles ou forestiers sont artificialisés en France, soit l’équivalent de cinq terrains de football chaque heure (source : ministère de la Transition écologique).
La méconnaissance du public et des acteurs du patrimoine
La biodiversité associée au bâti ancien est souvent méconnue, tant par le grand public que par les professionnels de la rénovation.
Cette ignorance peut conduire à des actions préjudiciables, comme la destruction involontaire de nids lors de travaux ou l'utilisation de matériaux inadaptés.
Par exemple, l'installation de filets anti-pigeons sans étude préalable peut piéger et tuer des espèces protégées comme les martinets noirs. Une sensibilisation accrue et une formation adaptée des acteurs du patrimoine sont donc essentielles pour intégrer la préservation de la biodiversité dans les projets de réhabilitation.
Comment concilier préservation du patrimoine et biodiversité ?
Intégrer la biodiversité dès les phases amont de restauration
Pour harmoniser la restauration du bâti ancien avec la préservation de la biodiversité, il est essentiel d'adopter une approche proactive dès les premières étapes des projets.
Cela implique de :
- Réaliser un diagnostic écologique préalable : avant d'entamer des travaux, un inventaire des espèces présentes permet d'identifier les enjeux écologiques spécifiques au site.
- Planifier les interventions en fonction des cycles biologiques : éviter les périodes sensibles, telles que la nidification (généralement de mars à août) ou l'hibernation, pour minimiser les perturbations sur la faune.
- Mettre en place des mesures compensatoires : si des habitats doivent être modifiés ou supprimés, l'installation de nichoirs artificiels ou de gîtes à chauves-souris peut offrir des refuges alternatifs aux espèces concernées.
Exemple : L’église Saint-Maurice à Mertzen (Alsace)

Martinets noirs et chauves-souris dans les combles de l’église de Mertzen (Alsace) – © EPAGE Largue
La commune de Mertzen, avec l’appui de la LPO Alsace et du GEPMA, a engagé la restauration extérieure de l’église Saint-Maurice tout en intégrant les enjeux de biodiversité. Le projet a bénéficié du soutien de la Fondation du patrimoine, dans le cadre de son programme « Patrimoine naturel & Biodiversité ».
Un diagnostic écologique précis a mis en évidence la présence de plusieurs espèces protégées nichant ou s’abritant dans l’édifice : 21 couples de martinets noirs, une chouette effraie installée dans le clocher, et plusieurs individus d’oreillard (chauves-souris).
Grâce à une planification rigoureuse des travaux tenant compte du cycle biologique des espèces (pause estivale, échafaudages à distance des loges), à l’installation de 52 nichoirs, et au maintien des sites de nidification existants, les espèces ont été préservées. À l’issue du chantier, la reproduction des martinets a été un succès : 46 jeunes ont pris leur envol. L’église et ses abords sont en cours de labellisation Refuge LPO, ce qui garantit un suivi écologique régulier dans la durée.
> En savoir plus sur ce projet
Adopter une gestion écologique des abords des bâtiments
Les espaces entourant le bâti ancien jouent un rôle crucial dans le maintien de la biodiversité locale. Une gestion écologique de ces zones peut être mise en œuvre en :
- Préservant la végétation existante : conserver les arbres, haies et zones herbacées favorise la présence d'insectes, d'oiseaux et de petits mammifères.
- Limitant l'utilisation de produits chimiques : réduire ou éliminer l'usage de pesticides et d'herbicides protège les chaînes alimentaires locales et préserve la santé des écosystèmes.
- Pratiquant une gestion différenciée des espaces verts : adapter la fréquence des tontes et des fauches selon les zones pour favoriser la floraison et offrir des habitats diversifiés.
Exemple : La Tour de la biodiversité du château de Belmont (Occitanie)
Ce projet, porté par l’Association Château-Neuf des Peuples, a été lauréat du programme « Patrimoine naturel & Biodiversité » en novembre 2023. Il consiste à restaurer une tour médiévale en y intégrant des dispositifs favorables à la faune sauvage. L’objectif est de transformer cette structure architecturale en véritable refuge pour la biodiversité locale.
Les porteurs de projet prévoient plusieurs actions concrètes : installation de nichoirs pour les oiseaux cavernicoles (hirondelles, chouettes), aménagement des différents étages pour accueillir des chauves-souris et préservation des abords en favorisant une gestion écologique du site. Cela a inclus la plantation de haies et la restauration des murets en pierre sèche, éléments essentiels pour les insectes et petits mammifères.
> En savoir plus sur ce projet
Favoriser des solutions adaptées aux contraintes patrimoniales
La conciliation entre préservation du patrimoine architectural et biodiversité nécessite des solutions sur mesure. Pour cela, il est recommandé de :
- Collaborer avec des experts en biodiversité : travailler avec des associations spécialisées, telles que la LPO, pour bénéficier de conseils adaptés aux spécificités locales.
- Intégrer les recommandations écologiques dans les cahiers des charges : inclure des clauses spécifiques pour la préservation de la faune et de la flore lors de la planification des travaux.
- Utiliser des matériaux et des techniques compatibles : privilégier des matériaux traditionnels et des méthodes de construction respectueuses de l'environnement qui n'altèrent pas les habitats existants.
Exemple : Programme « Bâti rural et biodiversité inféodée » (Auvergne Rhône-Alpes)

Cabane en pisé à la Côte-Saint-André – © Jean-Baptiste Decotte
Plusieurs initiatives illustrent cette conciliation réussie entre bâti ancien et biodiversité, notamment en région Auvergne-Rhône-Alpes.
Porté par la LPO Auvergne-Rhône-Alpes, ce programme a été lancé en 2023 avec le soutien de la Fondation du patrimoine. Il vise à préserver la faune inféodée aux bâtiments anciens dans les territoires ruraux. La LPO intervient à chaque étape : elle réalise les diagnostics écologiques, conçoit les aménagements adaptés à chaque espèce et accompagne les travaux de restauration.
Ce programme pilote concerne une quarantaine de sites répartis sur plusieurs départements (Loire, Rhône, Isère, Drôme, Ardèche, etc.). Il cible des espèces patrimoniales comme la Chouette effraie, la Chevêche d’Athéna, le Moineau friquet ou le Petit rhinolophe.
Parmi les premières actions menées :
- À Pommiers (Rhône), une cave a été réaménagée pour permettre l’accueil d’une colonie de Petit rhinolophe, une espèce de chauve-souris protégée, en recréant des conditions d’obscurité et de calme.
- À Saint-Haon (Loire), les propriétaires d’une loge viticole ont accepté l’installation de gîtes à chauves-souris et de nichoirs pour la Chevêche d’Athéna et l’Hirondelle rustique.
- À Gigors-et-Lozeron (Drôme), une grange agricole a été sécurisée pour héberger le Grand rhinolophe en restaurant le plancher et en aménageant les ouvertures.
Les interventions sont conçues pour être réversibles, respectueuses du bâti et compatibles avec les usages agricoles. Ce programme illustre concrètement comment le bâti rural peut redevenir un réservoir de biodiversité.
> En savoir plus sur ce projet
> Pour aller plus loin :
- Le guide pratique édité par la LPO destiné aux propriétaires d'édifices classés au titre des monuments historiques, afin d'accueillir la biodiversité sur leur site.
- L'ensemble des outils pédagogiques sur le thème de la biodiversité édités par la LPO.